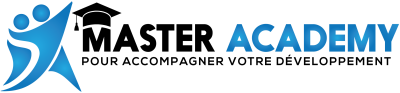Coaching et psychothérapie… Quelles frontières ?
La difficulté se situe dans l’articulation du principe d’autonomie du patient et du principe de bienfaisance. Si le patient individuel n’a pas nécessairement la connaissance du thérapeute (ou du coach), il est quand même en mesure d’évaluer les impacts des changements évoqués sur son histoire personnelle, sur le sens de son existence et, plus généralement, sur sa vie de tous les jours.
Mais pour pouvoir exercer son jugement, un dialogue constructif est nécessaire entre le thérapeute et le patient. Le thérapeute doit toujours être en capacité de laisser la possibilité au patient de prendre les décisions qui vont affecter sa vie de tous les jours. Aussi, une frontière très nette entre le coaching, la (psycho)thérapie et le développement personnel est assez difficile à établir, d’autant que certaines méthodes et outils utilisés par les professionnels des thérapies brèves et du coaching centré sur la personne, sont souvent relativement proches.
La psychothérapie s’adresse avant tout au champ de l’inconscient (personnel et collectif), des sensations et du ressenti, des émotions, des sentiments et des pensées, des scénarios de vie élaborés dans l’enfance, des figures parentales… Sa finalité est de réparer des blessures du passé, de libérer des blocages inconscients et de permettre l’accès du patient à ses motivations les plus profondes.
Le coach professionnel n’a ni la formation, ni les moyens, ni même les protections nécessaires pour aborder sereinement ces différents sujets (le passé, “papa”, “maman”, l’inconscient…), même s’il est important qu’il ait un minimum de culture dans le domaine. En effet, cela lui permet d’évaluer la demande et de pouvoir (éventuellement) diriger le coaché vers un professionnel compétent en matière de thérapie, si cela s’avère nécessaire.
Le développement personnel s’adresse, quant à lui, au champ des positions de vie (ce que je pense de moi et ce que je pense de l’autre), des attitudes et des comportements. L’ouverture au développement intérieur de la personne concerne sa “carte du monde” (sa représentation de la réalité), c’est-à-dire ses croyances sur elle-même, sur les autres et sur les événements ; mais aussi la façon dont elle utilise ses valeurs et ses croyances pour justifier ses comportements et ses décisions.
En réalité, le coaching traite des conséquences des croyances, quand la psychothérapie traite de leur origine. Cette dernière vise à soulager la souffrance psychique en priorité, quand le coaching vise à atteindre un objectif professionnel (ou de vie) de manière plus ou moins immédiate ; alors que la thérapie s’inscrit dans une démarche structurelle qui demande du temps.
De mon point de vue, même si la frontière entre coaching et psychothérapie peut sembler ténue, elle est bien réelle. Ainsi, le fait de faire travailler un coaché sur sa sphère personnelle, sur ce qu’il vit, sur la façon dont il fonctionne (avec ses croyances et ses ressentis) entraîne pour le coach une remise en cause permanente de ses propres croyances. Dans sa pratique de tous les jours, le coach est d’ailleurs condamné à gérer les frontières entre thérapie et coaching d’une part, et entre conseil et coaching d’autre part.